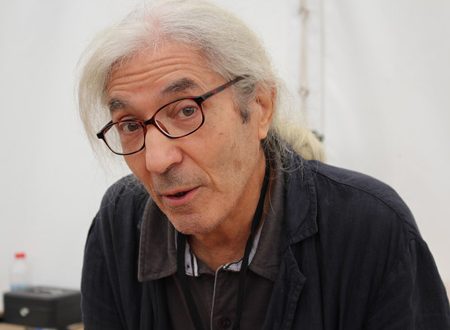Samedi matin
Samedi 9 h 54 – Vous vous êtes réveillée avec le sentiment réconfortant d’avoir quarante-huit heures rien que pour vous. Deux jours de plaisirs oisifs, de cafés longuement savourés, de lectures inspirées, de dîners partagés et de sport déculpabilisé. Cette douce plénitude vous envahit totalement, quand soudain… vous remarquez que l’étagère de votre chambre, votre précieuse et fidèle Billy, semble prête à s’effondrer sous le poids des trésors qu’elle contient. La faute, sans doute, aux douze livres achetés l’année dernière sur la méditation, aux albums photos de vos années de lycée, aux souvenirs rapportés d’Inde l’été 1998, et aux encyclopédies qu’aucun site Internet n’est parvenu à vous faire jeter. La solution serait certainement de faire du tri, mais ces objets, vous les aimez, vous ne voulez pas vous en séparer. D’autant qu’il suffirait simplement de rajouter un autre rangement, juste à côté, pour y classer de nouveaux souvenirs.
C’est ainsi que, nourrie par une vague d’enthousiasme, vous parvenez à convaincre votre âme sœur d’aller bruncher dans le temple de l’amusement pour adultes : IKEA. Quelques lettres si familières, si rassurantes, qui vous suivent depuis votre installation dans votre première chambre d’étudiante. Du bois, des concepts, des noms sympathiquement imprononçables, de la bienveillance suédoise, bref, le plan parfait. La voiture est prête, le coffre est vide, prompt à recevoir vos trouvailles, car, en plus d’une étagère, vous vous êtes aperçue qu’il faudrait sans doute renouveler vos casseroles, votre linge de lit, remplacer le support télé et penser à une jolie table basse pour habiller le salon. Catalogue en main, vous avez consciencieusement coché les pages qui vous intéressaient. Vous franchissez la porte du magasin, le sourire béat face à tous ces possibles cachés dans la tôle bleutée. Le parcours commence, plus facile que l’accrobranche. Vous suivez les flèches au sol, acceptant que l’on contraigne votre libre arbitre à suivre un chemin balisé. Au premier virage, vous saisissez un petit crayon de bois avec une excitation enfantine. Vous contemplez avec admiration les appartements modèles qui démontrent, preuves à l’appui, que l’on vit aussi bien dans un loft que dans 18 mètres carrés, et que le bonheur tient à quelques élégantes solutions de rangement.
Vous poursuivez lascivement votre promenade, éprouvant une fascination pour l’espace literie, délimité par une affiche, semblable à un mantra ou un conseil de vie d’un thérapeute familial : « La chambre ? Séparer sans cloisonner. » Parvenu au rayon enfant, vos jambes commencent à flancher. Voilà déjà deux heures, que vous piétinez dans les allées. Votre panier n’est pour l’instant rempli que d’un plaid en matière synthétique, trois paquets de serviettes en papier motif rennes, et deux louches en plastique qui serviront sans doute le jour où vous ferez une monodiète de soupe. Vous êtes poussée par cette irrépressible envie, cet élan qui vous conduit à dire qu’exister, c’est persévérer dans votre désir de dépenser. Vous essayez d’accélérer la cadence, mais vous vous laissez absorber par la vue d’un adorable crocodile en peluche. Votre partenaire commence à hausser légèrement le ton : « Et ta peluche, elle va finir comme celle de l’année dernière ? Au fin fond de la cave ? En collocation avec les mites ? » Vexée, vous faites face à votre frustration, et lui roulez sur les pieds avec votre caddie. Vous feignez de ne pas entendre son cri de douleur. Puis, dans un élan d’efficacité, vous tentez de résister au chemin imposé, parvenant illégalement au rayon bureautique, en enjambant une chaise à trois pieds au design appliqué. Au rayon luminaire, dans un mélange de colère et de chaleur, vous dégoulinez de transpiration. Mâchouiller le bout de votre crayon en bois ne suffit pas à vous calmer.
Après quelques moments d’errance, il est largement l’heure de rejoindre l’espace rangement. Entre-temps, vous avez perdu les références des produits que vous aviez repérés, le catalogue est resté posé sur une pile de porte-serviettes en kit. D’une main rageuse, vous saisissez n’importe quoi. Rien ne semble apaiser votre énervement. Vous frôlez la rupture au moment où votre partenaire vous demande : « Qui va encore monter tout ça ? » et vous vous emparez d’une visseuse-dévisseuse d’un geste agacé, avec un fort sentiment d’affranchissement. Que se passe-t-il ? Vous avez basculé. La puissance que vous sentez jaillir en vous ne peut pas être contenue, vous avez beau tenir des discours sur la société de consommation, ici, à ce moment-là, votre désir est illimité, sa durée indéfinie.
C’est le début du chaos. La table basse vous a trompée sur ses dimensions. Vous entendez, au loin, un individu hurlant : « Bah tu l’avais pas mesuré avant ? » Le meuble télé, si raffiné sur papier glacé, montre un peu trop ostensiblement son contreplaqué, et le portemanteau sur lequel vous aviez flashé s’est déjà affiché au bureau et dans votre dernier Airbnb. Vous pestez sur la conformité. Cela ne vous empêche pas de vous déchaîner, en attrapant quatre bougies senteurs fruits rouges et vanille, deux packs d’assiettes, et un yucca en plastique, que vous cachez rapidement dans votre cabas jaune. Vous ne savez plus où votre désir vous mène. La personne qui vous accompagne vous dévisage avec mépris, vous lui renvoyez un sentiment identique au moment où elle casse une ampoule pour halogène en la lançant dans le chariot. Le combat s’achève dans l’espace libre-service, où vous vous sentez diminuée par ces hauteurs remplies de paquets à perte de vue, promesses de soirées entières à tenter d’utiliser un tournevis. Vos affaires se cachent quelque part entre les allées B18 et D24. Vous saisissez votre téléphone pour retrouver les références que vous aviez sauvegardées, convaincue que la libération est proche. C’est alors que vous découvrez, horrifiée, que votre mobile est éteint : vous n’avez plus de batterie. Il faut recommencer tout le périple ou dire adieu à vos meubles. Votre désir ne peut pas être assouvi. Les minutes qui suivent se déroulent dans une quasi-transe, teintée de sanglots, d’insultes, de découragement, et d’un ticket de caisse de 236, 80 euros pour des objets dont vous ne connaissez pas réellement l’utilité. Vous reprenez la voiture, excédée. Votre couple est proche de l’implosion alors que vous vouliez simplement acheter une étagère. Il est 19 h 14 et les embouteillages du retour vous laissent prendre pleinement conscience de vos courbatures, de votre sueur, de votre infini désarroi, et de votre détestation profonde du jaune et bleu.
Et il dit quoi Spinoza de tout ça ?
Il est important d’admettre, dès le départ, que Spinoza n’a sans doute jamais voulu acheter une étagère Billy. En revanche, le désir, la vertu, l’adversité, et tout ce qui s’ensuit, le philosophe, Spinoza, Baruch de son prénom, connaît plutôt bien et met tout en œuvre pour vous déculpabiliser.
Le premier mérite de sa pensée, en cas de dépression post-samedi chez Ikea, est bien de nous faire comprendre les mécanismes de notre humanité et donc de nos actes. Il se veut rassurant, et explique que chaque individu est caractérisé par un conatus. Pas de panique, cet étrange terme est moins effrayant qu’il n’en a l’air, puisqu’il décrit, tout simplement, une pulsion. Une sorte de force qui nous conduit à nous lever le matin et à éprouver la joie d’exister. Résumons un peu notre affaire. Pour Spinoza, l’homme fait partie de la Nature qui a été créée par Dieu. Donc chaque homme est le représentant des super-pouvoirs divins. À ce titre, nous sommes emplis d’une vive énergie directement venue du ciel, qu’on est farouchement déterminés à conserver, quitte à faire de gros efforts pour la garder intacte. Le conatus est donc notre zone protégée, le truc auquel il ne faut pas toucher, et qui fait que nous sommes des créatures naturelles (et pas des personnages de jeux vidéo).
Ce conatus porte souvent un autre nom, moins drôle à faire rimer, mais un peu plus grand public : le désir. Et c’est bien à ce moment-là que Spinoza devient un excellent thérapeute qu’on aimerait avoir en podcast dans nos oreilles lors de chaque après-midi shopping. Dans sa philosophie, le désir, l’appétit, la volonté, la pulsion deviennent des valeurs universelles, qui constituent notre nature profonde, et nous animent. Pas la peine de lutter, il est impossible de s’en défaire puisque c’est ce désir qui montre que nous sommes en vie. Plus qu’une tare, avoir du désir est même une bonne nouvelle, le signe qu’on fait partie de la liste des VIP de la communauté humaine. Il va même jusqu’à écrire : « Le désir est l’essence de l’homme. » On ne peut pas le mettre de côté, le comptabiliser, le minuter, car le désir, ce petit conatus, est infini. Seule la mort peut l’arrêter, mais certainement pas un compte en banque un peu trop déficitaire ou un appartement déjà surchargé. Le désir est le témoin de notre vie. Mais, attention, il ne suffit pas de se lever pour le ressentir, il n’existe pas de manière abstraite, dans le vent. Au contraire ! Le désir ne se montre qu’à travers des situations, comme aller chez Ikea par exemple, et se mettre à rêver devant des paquets de serviettes en papier. C’est dans un contexte qu’il s’agite et embrase nos pensées.
Marie Robert.
Kant tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo.
Flamarion, 2018.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris