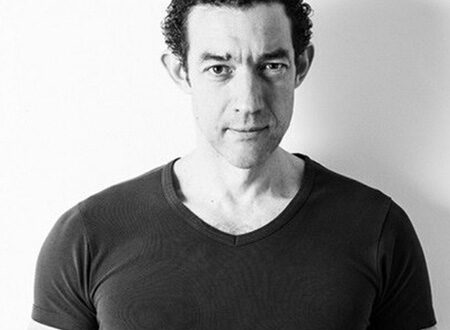Marcher
La comparaison de la marche et de la pensée s’appuie sur la notion de paysage : la philosophie habite les problèmes, comme le marcheur habite les paysages, surtout quand il effectue de très longues marches en montagne ou en plaine, de grandes excursions, des randonnées – autre chose en tout cas qu’une simple promenade : les maisons, il les traverse, mais c’est dans le paysage qu’il demeure. Voilà toute l’expérience du marcheur : en franchissant le seuil, il ne sort pas vraiment de chez lui ; plutôt il va de gîte en gîte, toujours provisoires, gîtes d’un seul soir. Et quand il sort le matin pour marcher, il sort dans ce complexe de vallons, dans ce cirque, dans cette montagne, cette combinaison de collines. Le corps habite alors le paysage, qui devient sa véritable demeure, une présence familière et continue, sans pour autant qu’il y ait fusion. C’est une façon d’être au milieu des choses, avec l’idée que ce « milieu » n’est pas une extériorité étrangère. Au-delà, il y a l’idée que des paysages vous ressemblent. Mais ce n’est pas un simple jeu entre l’âme et l’espace, comme si un état intérieur se projetait dans certaines formes, certains dessins, certaines couleurs. C’est plutôt une rencontre qu’une correspondance. Il s’agit pour chacun de trouver son paysage. Cette découverte se trahit par une vibration soudaine et harmonique entre le corps et le paysage, par une évidence pour le marcheur : c’est bien moi – moi, ce corps vivant –, c’est bien moi ce paysage.
Ce tissage du corps et du paysage par la marche prend d’autres formes encore. On dira d’abord que le paysage, par sa beauté, sa magnificence, nourrit le corps du marcheur : il le remplit d’énergie. L’espace alors n’est pas du tout vécu comme un simple cadre vide, un milieu transparent. Ce n’est pas un espace géométrique, mais comme un immense corps vivant censé transmettre des énergies élémentaires. Ces énergies, c’est ce que Thoreau appelle « the wild ». Le wild, c’est le sauvage, mais pas au sens d’une origine. The wild, c’est ce que Hölderlin désignait comme l’éclat des dieux, ce que Rimbaud appelait la vigueur : tout ce qui se trouve, avec son intensité première, dans une Nature encore indomptée, des espaces sauvages, des paysages inhabités. Et marcher, c’est toujours aller en direction de ces forces, en direction, comme Thoreau le dit dans Walden, des forces du matin. Ces énergies, ce sont celles qui nous permettent d’avancer, de nous réinventer : les forces intactes de l’avenir. C’est là qu’on pourrait retrouver la philosophie. Car ce que sont au marcheur les énergies premières du grand air ou des forêts, ce qu’on appelle les questions « éternelles » le sont au philosophe. La philosophie n’avance pas par acquis, par capitalisation. C’est une chose que l’on a dite et répétée souvent : il n’y a pas de progrès en philosophie. Comme le marcheur toujours, pour se réinventer, va trouver dans sa marche une descente vers ces forces élémentaires qui sont en même temps celles de l’avenir, ainsi la philosophie puise ses capacités d’invention en affrontant ces questions immenses, qui constituent son éternel printemps.
On peut encore aller plus loin dans l’évocation de cette appropriation active du paysage par le corps du marcheur, pour rendre compte d’une intensité promise. C’est une chose bien connue : vous parvenez en voiture à un point de vue ; vous sortez du véhicule, admirez, contemplez, prenez des photos. Mais parvenir à ce même endroit en marchant plusieurs heures délivre autre chose. Bien sûr, il y a l’effet de l’effort, en ce sens que l’effort physique fragilise, et cette fragilité rend plus sensible, plus impressionnable. D’autre part, il y a la lenteur de la marche, qui permet autre chose qu’une simple prise de vue. Le paysage n’est plus un objet qui m’est opposé, parce que je me le suis approprié lentement, pas après pas. Dès lors, ce n’est pas seulement par les yeux que je prends possession du paysage, mais toutes les fibres du corps se l’approprient, à travers d’autres valeurs que les formes, les volumes, les proportions évalués par le regard : je sens la qualité et la dureté du sol, tous les parfums qui m’imprègnent, les changements de lumière.
Cette idée d’effort permet de faire apparaître un dernier rapport entre le corps et l’espace. L’effort précisément de la marche est régulier, constant, lent, exigeant. Ce qui signifie, si ce n’est une souffrance, au moins une certaine fatigue. La beauté des paysages conquis par la marche est supérieure parce qu’elle apparaît au marcheur sous la figure d’une récompense. On trouve chez Épicure un concept qui peut nous aider à cerner cette figure : la notion de gratitude (kharis, en grec). La gratitude, c’est le bonheur pris à se trouver le destinataire d’un don. C’est une attitude de remerciement. Par la gratitude, j’exprime ma joie de recevoir, mais en l’adressant directement à celui qui me donne. La gratitude interdit toute idée de dépendance. Je reçois, mais en retour je ne me trouve pas prisonnier du don : je suis reconnaissant envers celui qui m’a donné, avec l’idée d’une joie de la reconnaissance tout autant que du don reçu. Par l’effort, le marcheur est parvenu au détour d’un col, et la beauté du paysage qui s’ouvre à lui, il la reçoit comme une récompense, comme si le paysage le récompensait de ses efforts par une intensité particulière. Il peut donc s’abandonner à la beauté du paysage, plutôt que d’en prendre possession comme celui qui descend simplement d’un véhicule pour en saisir une image. Dans la marche, le rapport entre le corps et le paysage n’est pas un rapport d’image, de représentation. Je ne regarde pas le paysage, mais je m’en imprègne. Comme le dit Nietzsche, et je répète sa formule : « Il est de mon sang, et même plus encore. »
Frédéric Gros.
Petite bibliothèque du marcheur.
Champs classiques, 2017.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris