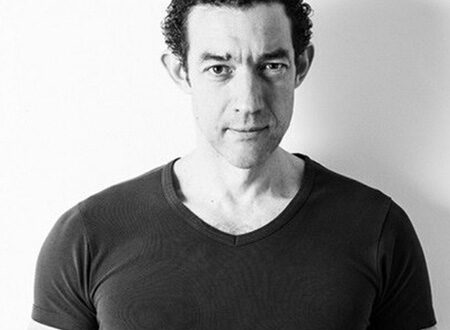Hyper
Les sociétés modernes se sont érigées sur trois piliers formant système : l’individualisation, le rationalisme et la foi dans le progrès, et l’« économisation » de la société, c’est-à-dire l’emprise croissante de l’économie et des valeurs qui lui sont associées (les vertus de la concurrence, l’importance donnée à la croissance économique, la valorisation de la réussite financière…). Cette alchimie a été capable du meilleur comme du pire. S’il est souvent de bon ton aujourd’hui de dénoncer ses travers, nous lui devons de vivre de plus en plus longtemps, à l’abri de la douleur et de la faim, dans un niveau de confort inégalé… et dans un cadre démocratique qui assure à chacun le respect de ses droits fondamentaux. La « modernisation » de certains pays en retard de développement en a fait des « pays émergents » (la Chine, l’Inde, le Brésil…), et le formidable élan de croissance dont ils ont bénéficié a favorisé un recul significatif de l’extrême pauvreté dans le monde. On notera que ces pays ne sont pas touchés par la montée de l’intégrisme et qu’à l’inverse les zones du monde d’où émerge la contestation des valeurs de l’Occident et, finalement, le chaos, sont des zones qui peinent à entrer dans la modernité. Si la croissance économique n’est pas une fin en soi et si, mal maîtrisée, elle peut produire des effets délétères, le social progress index, construit à partir d’une cinquantaine d’indicateurs pour une centaine de pays par le Social Progress Imperative, se révèle comme étant clairement corrélé au niveau de revenu par tête des pays1.
La modernité a déjà vécu des crises et de sérieux coups de canif ont été portés au contrat initial : la Grande Guerre, la crise de 1929, la Shoah… Néanmoins, plus proche de nous, les Trente Glorieuses ont comme effacé l’ardoise en témoignant de la force du progrès social résultant de la combinaison d’un individualisme porteur d’émancipation personnelle, d’un progrès technique participant d’une conquête du pouvoir de l’homme sur les forces de la nature et sur l’organisation de la société, ainsi que d’une dynamique économique productrice d’un progrès matériel profitant au plus grand nombre. Pourtant, cet « âge d’or » portait en germe les défis majeurs que nous devons aujourd’hui affronter, sous peine de voir s’effondrer le projet moderne et les sociétés occidentales s’aventurer dans des directions dangereuses.
Le défi sans doute le plus important que nous lance notre époque est d’ordre écologique. Il est désormais acquis que nous avons vécu sur un modèle de développement insoutenable sur le moyen terme*2. Ce défi est colossal, car il y va de l’avenir de l’humanité, rien de moins. Éviterons-nous la catastrophe par plus de modernité encore, par notre foi dans la science, dans la sagesse des politiques ? Ou bien devrons-nous renoncer à nos modes de vie, voire nous résoudre à entrer en conflit ouvert à l’échelle de la planète pour le partage de ressources de plus en plus rares ? En réalité, la question écologique nous renvoie elle aussi aux limites d’une société centrée sur la consommation.
La civilisation occidentale est progressivement devenue ce qu’il est convenu d’appeler la « société de consommation », c’est-à-dire une société dans laquelle la consommation est devenue une valeur cardinale, un élément central de nos vies quotidiennes, de nos buts, de nos rêves, un support de la construction de nos identités, une composante majeure de nos manières de faire société…
Mon hypothèse est que notre société est malade de sa consommation, devenue une « hyperconsommation*3 », de son impact environnemental, de l’importance de la place qu’elle occupe, des effets délétères qu’elle génère.
Il va de soi que faire la critique de la consommation conduit à faire la critique du capitalisme. Le capitalisme, qui ne se conçoit pas sans croissance, est un système profondément dynamique. Il ne trouve d’équilibre que dans le mouvement, l’investissement dans l’espoir d’un profit qui viendra accroître le volume des capitaux investis… Mais la production doit trouver ses débouchés. La croissance de la consommation, comme stade ultime du circuit économique, est indispensable à la dynamique d’ensemble.
Il est donc dans la logique même du capitalisme d’étendre de manière continue la sphère de la consommation marchande. Il opère pour cela selon deux processus complémentaires. Tout d’abord, par un processus continu de marchandisation, consistant à monétiser une part toujours plus importante des besoins humains. Ensuite, par la création de nouveaux besoins, l’entretien continu du désir. Pour vendre plus (et parfois plus cher), les entreprises ont appris à exploiter les ressorts sociologiques et psychologiques de la consommation, à jouer sur les logiques statutaires, à titiller les pulsions les plus inconscientes, à surfer sur les valeurs, à nourrir leurs produits d’imaginaires, à faire de leurs marques des signes de reconnaissance… L’« hyperconsommation » s’appuie sur l’efficace relais des industries culturelles. Le système qui en découle assure la promotion des valeurs matérialistes, notamment la réussite économique au détriment des autres formes de reconnaissance sociale ou, plus généralement, des systèmes de valeurs pouvant désigner d’autres voies pour une vie réussie.
La société malade de l’hyperconsommantion.
Philippe Moati.
Odile Jacob, 2016.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris