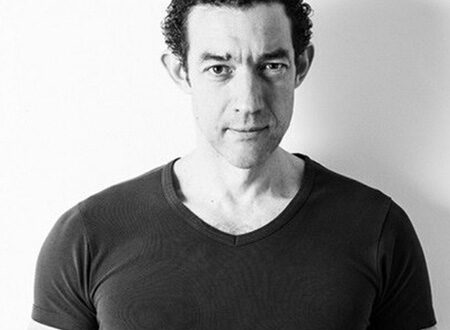Contradiction
La contradiction entre l’essor des technologies que l’on voudrait croire toujours favorable au progrès économique et l’appauvrissement des classes populaires au XIXe siècle n’a cessé de troubler les économistes. Robert Allen a parlé de « pause d’Engels », en référence au passage cité, pour caractériser cette explosion de misère au sein d’un monde réputé plus productif. La révolution numérique en offre un nouvel exemple. Elle est au cœur d’une nouvelle paupérisation ouvrière sans en être toutefois toujours la cause première. La principale origine du dérèglement social contemporain, particulièrement aux États-Unis, est la révolution libérale de Reagan. Sa cible a été le pouvoir des syndicats. Ceux-ci ont toujours joué un rôle important en matière d’égalité salariale, poussant à une forme de redistribution interne au profit des échelons les plus bas de la hiérarchie sociale. En procédant à une externalisation des tâches les moins qualifiées, les entreprises ont brisé cette aspiration. Philippe Askenazy a montré dans sa thèse que les premières firmes à faire l’objet d’une restructuration, d’un « re-engineering », étaient souvent les plus syndicalisées3. Dans le nouveau monde productif qui s’installe dans les années quatre-vingt, les technologies de l’information et de la communication viennent en quelque sorte après coup : elles rendent possible une organisation du travail où les tâches sont déléguées à des firmes toujours plus éloignées. Le fax a été un premier instrument révolutionnaire permettant de faciliter la transmission de données d’une entreprise à l’autre. Puis dans le courant des années quatre-vingt-dix, avec Internet, la mutation a été totale.
Dans ce nouveau système, les firmes les plus performantes deviennent les opérateurs d’une mosaïque d’autres entreprises auxquelles sont déléguées les activités les moins rémunératrices. L’apparition de firmes « superstars » et dont le contenu en emplois est faible est l’expression la plus visible de cette transformation. C’est le modèle dont les GAFA sont l’archétype mais qui est en réalité beaucoup plus général. Dans chaque secteur, les cinq entreprises les plus performantes ont considérablement augmenté leur part de marché. Or, à l’exception de la finance, elles sont beaucoup plus économes en travail que leurs concurrentes. Quel que soit le secteur considéré, moins une firme emploie de personnels, plus elle réussit. Les économistes parlent de « scale without mass », d’économies d’échelle sans pesanteur. Netflix ou Google peuvent doubler leur chiffre d’affaires sans avoir besoin de doubler leur personnel. La surprise est que ce modèle semble s’imposer partout, pas seulement dans le secteur des industriels numériques. Aux États-Unis, les cent premières entreprises produisaient un tiers de la valeur ajoutée globale. Leur part s’élève à 50 % aujourd’hui4. Ce sont ces firmes « superstars » qui contribuent pour beaucoup à faire baisser la part des salaires dans la valeur ajoutée.
Tous les pays ne sont pas également frappés par cette révolution. La France, par exemple, résiste à la baisse de la part salariale dans le revenu global. Elle le doit à une bonne et à une mauvaise raison. La mauvaise est qu’elle ne dispose pas comme les États-Unis de beaucoup d’entreprises à la frontière des mutations technologiques. La bonne raison est que ses institutions sociales, comme le salaire minimum ou la protection sociale en général, ont permis de mieux résister à l’érosion de la rémunération du travail. La France a été ainsi moins impactée par la hausse des inégalités, sans être toutefois totalement épargnée5.
La France a cependant été frappée comme la plupart des pays avancés par un ralentissement général de la croissance qui n’a cessé de se confirmer, décennie après décennie. Partout s’observe un essoufflement général des gains de productivité qui se traduit à terme, inéluctablement, par un ralentissement de la progression des salaires6. Le revenu des ménages, corrigé par sa taille, ne progresse plus guère, alors qu’il doublait tous les quinze ans dans les années soixante. En France comme aux États-Unis, la cause générale de ce ralentissement est indissociable de la « maladie des coûts » dont parlait Baumol : il est beaucoup plus difficile de générer des gains de productivité dans une société de services que dans une société industrielle. L’enjeu de la révolution algorithmique est certes de « résoudre » ce problème, mais elle commence tout juste, et du point de vue des travailleurs qui en subissent les effets, le remède peut être pire que le mal.
La conséquence majeure déjà visible de cette transformation du système productif est l’affaissement continu des emplois intermédiaires. Partout dans les pays avancés, en France comme aux États-Unis, ils ont vu leur part se réduire7. Les emplois « créatifs », tout en haut de l’échelle sociale, ont été les mieux traités. Ce sont les traders, les joueurs de foot, les producteurs d’algorithmes qui sont les grands gagnants du monde contemporain. Tous ceux qui peuvent utiliser les techniques numériques pour augmenter sans limites la taille de leur public ont bénéficié du nouveau monde qui s’installe. À l’autre bout de la chaîne, en bas de l’échelle sociale, ce sont les activités « sensibles » d’aide à la personne, de premiers de « corvée », qui ont le plus augmenté en nombre, tout en restant très mal payées. Cette polarisation entre les deux extrêmes accomplit la logique annoncée des avantages comparatifs des humains face aux machines, la sensibilité et la créativité. La force implacable des économies d’échelle enrichit sans limites les premiers tout en paupérisant les seconds privés de gains de productivité.
Homo economicus.
Daniel Cohen.
Albin Michel, 2022.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris