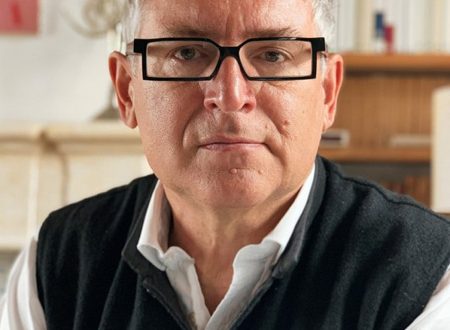Cerveau et mémoire
L’outil digital met notre cerveau en péril, que ce soit en agissant directement sur le cerveau (atrophie des circuits et diminution des corps cellulaires) ou bien par les modifications de nos comportements, les deux facteurs étant liés et interagissant l’un sur l’autre.
C’est ce que résume Raphaël Gaillard dans L’Homme augmenté. Futurs de nos cerveaux, en synthétisant des conceptions antidigitalistes : le risque de « donner naissance à un homo numéricus à la mémoire de poisson rouge tournant en rond dans les eaux agitées des réseaux sociaux, manipulé à dessein par des ingénieurs du chaos, jouets d’une technologie toxique au moins aux mains d’une élite toujours plus riche ».
Du fait de l’utilité indéniable de ce progrès, de la place incontournable qu’il a prise dans tous les secteurs de notre vie quotidienne, il serait illusoire de vouloir le supprimer ou même le remplacer dans certaines applications, mais si nous voulons sauvegarder l’avenir de notre cerveau, il faut l’accompagner et le maîtriser. Compte tenu de l’aspect non seulement utilitaire, mais aussi ludique et source de plaisir de cet instrument, il ne saurait être maîtrisé, associé, accompagné, voire remplacé que par une activité qui serait également source d’utilité et de plaisir, et cela sans provoquer d’atrophie cérébrale ou de troubles du comportement, mais au contraire en entraînant un développement de nos facultés cognitives et relationnelles.
Parmi toutes les activités humaines, seule la lecture nous semble remplir toutes les conditions requises. Observons d’abord que si la lecture provoquait des troubles comportementaux, depuis le nombre de siècles qu’elle est pratiquée, cela se saurait. Certes, la lecture d’un manifeste affiché peut amener des foules à manifester, mais c’est là l’expression d’une conviction et non de trouble du comportement. Si elle était une cause d’atrophie cérébrale, on aurait découvert depuis longtemps que la maladie d’Alzheimer frappe plus volontiers les libraires, bibliothécaires et écrivains. Au contraire, des études scientifiques ont démontré le caractère bénéfique de la lecture sur les volumes de la substance blanche et de la substance grise du cerveau, en observant des groupes de sujets lecteurs de livres comparés à des groupes témoins non-lecteurs et à des groupes adeptes assidus du smartphone. C’est ainsi qu’une étude américaine effectuée auprès d’enfants âgés de 8 à 12 ans a démontré que le temps passé à lire est corrélé à une connectivité fonctionnelle de la substance blanche entre le lobe occipital et les régions temporales gauches de contrôle du langage, de la vision et de la cognition. En revanche, la comparaison avec un groupe d’enfants non-lecteurs, mais assidus au smartphone témoigne d’une diminution de la connectivité entre ces différentes régions4.
La lecture est la seule activité humaine qui met en œuvre toutes les aires de notre cerveau, ainsi que les circuits neuronaux qui les connectent. Depuis les travaux de Stanislas Dehaene, neuroscientifique français spécialiste de la cognition et du cerveau en action et professeur au Collège de France, il est connu que la région baso-occipito-temporale gauche joue un rôle dans la lecture, puisque cette aire a été baptisée « visual world form area ». Elle est en fait en relation avec toutes les aires du cerveau : en premier lieu le cortex préfrontal, aire de l’attention qui amplifie l’intensité des stimuli, permettant ainsi de mieux les consolider et de les garder en mémoire.
Dès le choix du livre, notre cerveau est utilement mobilisé. En effet, ce choix peut nous être imposé par un enseignant suscitant obéissance, curiosité ou rébellion, mais aussi résulter de notre propre désir d’étendre nos connaissances d’un auteur, d’un sujet, d’une époque, ou dans un souci de distraction, en choisissant un roman policier ou satirique. Il peut être le fruit de l’envie de briller en société en éblouissant nos relations par notre savoir, notre culture, comme le Sabinus moqué par Sénèque. Le choix peut aussi être dicté par un besoin d’échapper aux soucis quotidiens, à la dépression ou au retentissement psychique d’une maladie. C’est ainsi que Michel Houellebecq, dans son roman Anéantir, dont le héros est atteint d’un cancer, écrit : « Il fut quand même surpris, dans l’après-midi du lendemain, de parvenir aussi vite à se détacher de sa propre existence, et de se passionner pour les inférences du génial détective et les sombres menées du professeur Moriarty ; quoi d’autre qu’un livre aurait pu produire un tel effet ? Pas un film, et un morceau de musique encore moins, la musique était faite pour les bien portants, mais même la philosophie n’aurait pas convenu et la poésie pas davantage, la poésie non plus n’est pas faite pour les mourants : il fallait impérativement une œuvre de fiction ; il fallait que soient relatées d’autres vies que la sienne. » Et il écrit plus loin qu’il avait un mal fou à sortir de son livre. Une autre écrivaine, Valérie Perrin, dans son roman Changer l’eau des fleurs, écrivait cette phrase : « Je pense que je n’aimerais pas mourir au milieu de la lecture d’un roman que j’aime. »
Une fois le livre ouvert, nous considérerons comme négligeable l’action bénéfique sur le développement des biceps du fait de tenir un livre avec ses mains, le format de poche ayant depuis longtemps remplacé les éditions de Plutarque pesant plus de 10 kilos. Observons plutôt ce qui se passe en lisant : par l’intermédiaire des yeux et des nerfs optiques, les lettres et les mots parviennent en 1/200e de seconde au centre de la vision du lobe occipital, qui comme son nom l’indique, se situe dans la partie postérieure du cerveau. Grâce à la mémoire, les mots sont reconnus, puis constituent des phrases par l’intermédiaire du lobe temporal et du lobe frontal. Ces phrases racontent une histoire provoquant des émotions, qui mettent en jeu l’amygdale située sous le cerveau, et le circuit limbique, circuit des émotions, suscitant notre jugement, notre appréciation par l’intermédiaire du lobe frontal, et accroissent nos souvenirs dans l’hippocampe. Parfois, ils peuvent provoquer d’emblée une réaction comme l’envie de se
Le lecteur est amené à compléter, à imaginer, à créer : « La lecture est pour nous l’initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte de demeures où n’aurions pas su pénétrer. C’est l’impulsion d’un autre esprit qui vient nous tirer de notre solitude et de notre paresse5. » C’est ainsi que de nombreux écrivains aimaient à lire une belle page avant de se mettre au travail, tels le poète Ralph Waldo Emerson avec Shakespeare, ou Dante avec Virgile. Ou, bien sûr, les auteurs du présent ouvrage avec Hergé.
Le cerveau sans mémoire. Un tsunami nommé smartphone.
Derez, Thierry & Tadié, Marc.
Cherche Midi, 2025.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris