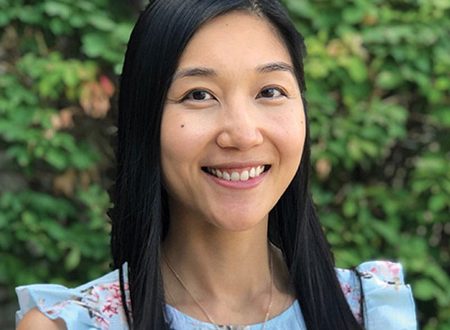Le chef
Un monde de chefs
Enfin le soleil d’York a changé en un brillant été l’hiver de nos disgrâces.
William Shakespeare, Richard III, acte I, scène 1.
Nous vivons une époque tout entière dominée par les chefs. Tant dans les régimes autoritaires qu’en démocratie, nous sommes gouvernés par une poignée de dirigeants qui organisent en notre nom la marche des affaires humaines. Alors que des bouleversements de toute nature viennent transformer notre réalité, que le monde se dématérialise, que l’architecture sociale se fissure et que les ordres établis vacillent un peu partout, la croyance dans le pouvoir d’une autorité incarnée demeure paradoxalement l’un des fondements les plus stables de l’organisation sociale. Il suffit pour s’en convaincre d’observer l’effervescence que suscite l’élection de chaque nouveau chef d’État, l’appétence populaire pour les têtes couronnées, et les succès de librairie des ouvrages consacrés aux « grands hommes qui ont fait l’histoire » ou qui tentent d’analyser les ressorts de l’autorité et du commandement1.
En dépit d’une apparente stabilité dans le temps, la foi dans la toute-puissance des leaders se renforce depuis plusieurs années à travers un phénomène de « présidentialisation » des démocraties. Historiquement construites à partir des révolutions américaine et française du XVIIIe siècle sur l’idée de la prééminence du pouvoir législatif sur l’exécutif, les démocraties contemporaines sont aujourd’hui le théâtre d’un phénomène inverse. Partout, les dirigeants de l’exécutif prennent le pas sur le Parlement. Ce processus se manifeste par un net élargissement des pouvoirs du gouvernement dans tous les pays démocratiques, dans un mouvement que nul ne semble songer à remettre en cause2. Cette tendance ne se limite pas aux seuls systèmes présidentiels. La Grande-Bretagne, le Canada ou le Japon, des régimes pourtant strictement parlementaires, sont concernés par l’affirmation nouvelle du pouvoir exécutif. Mouvement de long terme, cette tendance s’est accélérée au tournant des années 2000, alors que la scène internationale a vu s’imposer, pour le meilleur et pour le pire, des personnalités comme Bill Clinton puis George W. Bush, Tony Blair, Gerhard Schröder, Silvio Berlusconi ou Nicolas Sarkozy.
La France figure à l’avant-garde de cette lame de fond vers le présidentialisme. L’avènement de la Cinquième République a conféré au président des pouvoirs plus importants qu’ailleurs. Réactivée par le général de Gaulle, la figure de l’homme providentiel y a bonne presse, expliquant la succession d’hommes forts à l’Élysée depuis un demi-siècle.
Ce raffermissement du pouvoir des chefs s’est parfaitement adapté à la mondialisation de la démocratie. Il a rencontré l’imaginaire mystique de la fusion du peuple et du leader révolutionnaire, cher à la démocratie bolivarienne en Amérique du Sud, et dont Hugo Chavez a été l’une des figures totémiques. Il a fait corps avec la conception messianique de la politique indienne et avec son adhésion à un leadership charismatique empreint de religiosité, que l’on a pu observer de Jawaharlal Nehru à Narendra Modi. Il a également su épouser le mythe de la nation ethnique israélienne, soudée autour de ses Premiers ministres, depuis David Ben Gourion jusqu’à Benjamin Netanyahou3.
L’autonomisation des dirigeants vis-à-vis des systèmes politiques dans lesquels ils évoluent a également contribué à renforcer leur suprématie. Dans les régimes parlementaires comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne ou les pays scandinaves, dans lesquels les chefs de gouvernement sont encore issus des grands partis traditionnels, l’accès aux responsabilités les conduit à s’émanciper rapidement des partis qui les ont portés au pouvoir, et à entretenir une relation personnelle avec l’opinion publique. Dans les systèmes présidentiels, une telle évolution est devenue structurelle. Aux États-Unis, l’onction du suffrage universel rend le président américain, une fois élu, quasiment intouchable, y compris par le parti qui l’a soutenu dans sa course à la présidence. Donald Trump, haï par une grande partie des républicains qui ont assisté, médusés, à son ascension au cours des primaires, est une parfaite illustration de ce phénomène.
En France, la réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans et l’inversion du calendrier électoral, en 2000, ont renforcé la domination du pouvoir exécutif sur le Parlement, structurellement faible. L’absorption progressive d’une partie des fonctions du Premier ministre par le chef de l’État et l’effondrement des partis traditionnels lors des élections présidentielles de 2017 font, plus que jamais, du président de la République l’astre autour duquel gravitent tous les autres acteurs du système politique. Emmanuel Macron incarne à la fois une manifestation presque chimiquement pure de l’esprit des institutions de la Cinquième République, et l’acmé du tournant hyperprésidentiel pris par le régime depuis Nicolas Sarkozy. Fondateur d’un mouvement politique portant ses initiales, entièrement structuré autour de sa personnalité et dont le principal objectif était de le faire élire à l’Élysée, le président a revendiqué dès les débuts de son mandat une pratique verticale du pouvoir au détriment des corps intermédiaires, en relation directe avec l’opinion.
Vincent Martigny.
Le retour du prince.
Flammarion, 2019.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris