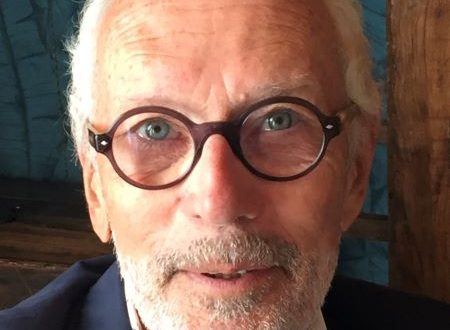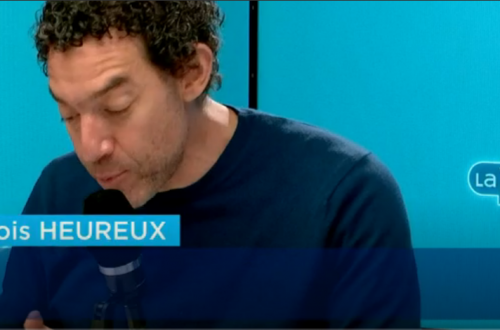Philosophesses
Franchement, y en a tout simplement RAS-LE-BOL d’être réduite à l’étiquette « dépendante de » l’homme.
Si les critères de définition du philosophe sont un peu obscurs, lorsqu’il s’agit des philosophesses le seul critère de filiation était évident. Dans le Dictionnaire de Richard Goulet, aux éditions CNRS, toutes les philosophesses antiques citées sont celles présentant l’inscription « philosophe » sur leur épitaphe. Ce ne sont pas nécessairement des penseuses qui ont écrit un ouvrage ou une thèse, parfois elles ont simplement appartenu à un cercle de discussion philosophique, mais elles avaient toutes en commun d’être affiliées à un philosophe : fille de ou femme de. Cette réduction identitaire va évidemment de pair avec l’effet Mathilda, encore elle, et ces qualificatifs sont des barrières invisibles qui maintiennent les inégalités et empêchent les femmes de briller pleinement dans le domaine intellectuel. Les conséquences sont triples : réduction de l’individualité, invisibilisation du travail, renforcement du stéréotype de genre. Pour mieux comprendre la gravité de ce mécanisme, penchons-nous sur le cas de la philosophe et scientifique Émilie du Châtelet, plus connue comme étant la « compagne de » Voltaire.
Émilie du Châtelet, née en 1706, est une aristocrate parisienne. Elle a la chance, pour l’époque, de partager dans sa jeunesse l’éducation de son frère et de rencontrer dans le salon tenu par ses parents de grands érudits. En 1733, Voltaire, déjà célèbre mais souvent en difficulté avec les autorités à cause de ses écrits satiriques et philosophiques, est un homme en quête de soutien et de refuge. Émilie du Châtelet, de son côté, est une femme mariée, mère de famille, et passionnée par les sciences et les mathématiques. Ils se rencontrent pour la première fois à Paris, dans les cercles aristocratiques et intellectuels qu’ils fréquentent tous les deux. Voltaire admire Du Châtelet non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son intelligence et son indépendance d’esprit. Quant à la jeune femme, elle est fascinée par Voltaire, cet esprit vif et provocateur, qui partage son amour des lettres et des sciences. Bien que la jeune femme soit mariée à Florent-Claude, Marquis du Châtelet, Voltaire et Du Châtelet entament une liaison. Le Marquis s’y résout rapidement et autorise même le jeune couple à vivre à Cirey, dans le château familial. Là, les deux amants vivent et travaillent ensemble pendant plusieurs années, transformant le château en un centre de recherche et de réflexion. Émilie du Châtelet est principalement connue comme étant la maîtresse de Voltaire, mais elle était surtout vulgarisatrice, traductrice, et philosophe, reconnue de son vivant. C’est la première femme à voir son travail scientifique imprimé par l’Académie de Paris. C’est également elle qui a traduit et commenté les Principia Mathematica, d’Isaac Newton, qui était alors encore peu connu en France. Elle traduit aussi Leibniz, au désespoir de Voltaire qui était son grand ennemi intellectuel. Émilie du Châtelet meurt en 1749, peu après avoir terminé son ouvrage sur Newton, laissant Voltaire profondément affecté par sa disparition. Quelques années avant, le philosophe lui témoignait publiquement son admiration pour son travail colossal tout en reconnaissant que ses capacités intellectuelles scientifiques le dépassaient : « vous avez pris un vol que je ne peux plus suivre », déclare-t-il lors d’une dédicace dans les années 1740.
Lorsque l’on qualifie une femme en fonction de son lien avec un homme, on minimise ou même occulte son travail, ses idées, et ses contributions. Cela renforce l’idée que sa valeur vient de son association avec une figure masculine, plutôt que de son propre intellect. Personne ne se souvient qu’Émilie du Châtelet est la première femme publiée par l’Académie de Paris ou la traductrice des principiae de Newton. Chaque intellectuelle mérite d’être reconnue pour ses propres idées, travaux et contributions, sans que cela soit systématiquement relié à un homme. Cette scientifique était une femme d’exception qui n’avait besoin de personne pour exister intellectuellement, alors n’est-ce pas un peu réducteur de la décrire comme étant la muse, la lumière, ou la compagne de Voltaire ? Ces qualificatifs réduisent son identité à sa relation, la privant de sa propre individualité. Utiliser ces termes perpétue également les stéréotypes de genre en suggérant que les femmes ne peuvent être des figures intellectuelles autonomes. On maintient ainsi des normes patriarcales où les hommes sont vus comme les détenteurs principaux du savoir.
Autre phénomène surprenant que j’ai découvert en rédigeant ce livre, c’est la manière dont les femmes philosophes sont nommées. Dans tous les ouvrages, et jusqu’aux articles les plus récents, il y a quasi systématiquement un moment du script où les intellectuel·le·s qualifient une femme par son prénom alors qu’un homme est toujours qualifié par son nom. Aucun article n’a jamais parlé de René, on parle de Descartes ou éventuellement de René Descartes. Pourtant, on lira l’histoire de Thérèse, pas D’avila ou Thérèse d’avila, ou encore l’histoire d’Émilie, et non Émilie du Châtelet ou Du Châtelet. N’est-ce pas fascinant de voir que ces barrières de genre ne sont pas si invisibles que ça, quand on y prête vraiment attention ? C’est-à-dire que, même lorsqu’un article critique le plagiat de Descartes pour revaloriser Thérèse d’Avila, le journaliste finit tout de même par réduire la philosophesse à son prénom, tant l’idée qu’une femme a moins de valeur que son homologue masculin est ancrée en nous. Le comble étant que certains de ces articles sont écrits par des femmes qui elles-mêmes font l’erreur. Ah… Patriarcat, quand tu nous tiens ! Est-ce vraiment trop demander d’arrêter de définir une femme par rapport à un homme, plutôt que par ses propres réalisations, et de l’appeler respectueusement par son nom ?
Philosophesses : Et autres outsiders de la pensée.
Léa Waterhouse.
Groupe Robert Laffont, 2025.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris